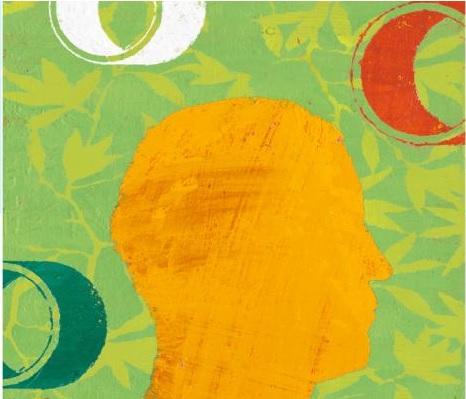Nous connaître
INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement est né le 1er janvier 2020. Il est issu de la fusion entre l’Inra, Institut national de la recherche agronomique et Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture.
Une ambition pour la vie, l'humain, la terre
L’humanité et la planète font face à un changement global qui crée de nouvelles attentes vis-à-vis de la recherche : atténuation et adaptation au changement climatique, sécurité alimentaire et nutritionnelle, transition des agricultures, préservation des ressources naturelles, restauration de la biodiversité, anticipation et gestion des risques. S’y ajoutent des enjeux plus territorialisés qui incluent les conditions de vie et de rémunération des agriculteurs, la compétitivité économique des entreprises, l’aménagement des territoires, l’accès à une alimentation saine et diversifiée pour chacun.
INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est né le 1er janvier de la fusion entre l'Inra et Irstea
Premier organisme* de recherche spécialisé sur ses trois domaines scientifiques, INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement contribue à relever ces défis. En proposant par la recherche, l’innovation et l’appui aux politiques publiques de nouvelles orientations pour accompagner l’émergence de systèmes agricoles et alimentaires durables, INRAE ambitionne d’apporter des solutions pour la vie, les humains et la terre.
Par le rapprochement de l’Inra, Institut national de la recherche agronomique, et Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, deux établissements reconnus pour la qualité de leur recherche et leur expertise, INRAE atteint une masse critique et mutualise des infrastructures de recherche importantes (observatoires, plateformes, banque de données) pour certaines uniques en Europe. Cette nouvelle position permet à INRAE des plus-values notoires dans différents domaines, comme les sciences de l’eau, les approches à l’échelle des territoires, la conservation et la restauration de la biodiversité, l’anticipation et la gestion des risques ou l’agriculture numérique.
*Index de spécialisation : part d'INRAE dans les 10 domaines suivants /part d'INRAE toutes disciplines confondues du Web of Science au niveau mondial : Agriculture, Plant sciences, Veterinary sciences, Genetics & heredity, Food science & technology, Nutrition dietetics, Biotechnology & applied microbiology, Environmental sciences & ecology, Water resources, Microbiology.
Télécharger la plaquette
pdf - 2.11 MB

Engagé pour repousser les fronts de science, INRAE vise les plus haut standards internationaux. Acteur majeur de la recherche européenne et membre actif de son dispositif (réseaux, projets H2020, Marie Curie…), il développe des partenariats bi ou tripartites. A l’international, ses collaborations s’organisent autour de laboratoires ou d’infrastructures partagés, une insertion dans les réseaux de recherche et une implication au sein des organisations internationales.
"On n'a jamais eu autant besoin de recherche" : Lire la suite
Une recherche utile à la société
Notre vocation est de
- produire et diffuser des connaissances pour répondre aux enjeux de société,
- mobiliser ces connaissances au service de l’innovation, de l’expertise et de l’appui aux politiques publiques,
grâce à une démarche qui s’appuie sur :
- une analyse interdisciplinaire et prospective des enjeux,
- une recherche repoussant les limites de la connaissance et porteuse de rupture,
- des partenariats académiques aux échelles régionale, nationale, européenne et internationale, avec une implication forte dans les écosystèmes régionaux de l’enseignement supérieur et la recherche,
- une expertise et un appui aux politiques publiques depuis l’échelon local jusqu’à l’international,
- des partenariats avec les acteurs du terrain : agriculteurs, entreprises, ONG, collectivités territoriales... chacun dans leur diversité d’orientations et de modèles,
- des dispositifs d’innovation ouverte qui permettent la circulation des idées, des connaissances et des expériences,
- des infrastructures de recherche et de données partagées,
- un dialogue avec les citoyens pour expliquer, débattre et participer.
et nous engage à appliquer les principes éthiques et déontologiques.
Un institut responsable
Nos orientations, nos pratiques de recherche peuvent s'inscrire dans des sujets qui font débat au sein de la société, et nos résultats de recherche peuvent nous donner matière à éclairer ces débats. Nous nous engageons à appliquer les principes éthiques et déontologiques de responsabilité, impartialité, intégrité, dignité et probité dans la réalisation de l’ensemble de nos missions. Nous nous appuyons sur les réflexions de notre comité d'éthique et de nos référents déontologie. Sur quelques uns de ces sujets, INRAE a formalisé ses principes, positions ou stratégies institutionnelles, ou encore formulé des avis, éclairés par les réflexions éthique et déontologique.
Acteur majeur des recherches menées au service des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, INRAE s’est engagé dans la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) pour contribuer à atteindre les ODD d’ici 2030, en faisant évoluer son fonctionnement et ses pratiques métiers. La stratégie RSE est mise en œuvre au travers d’un plan d’action ambitieux.

Déployer une démarche scientifique rigoureuse au service de l’intérêt général, s’interroger sur les enjeux éthiques de nos recherches, s’engager dans la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) pour contribuer à atteindre d’ici 2030, les objectifs du développement durable.
Première évaluation par le Hcéres pour INRAE
L’évaluation d’INRAE a porté, sur la période 2016-2020, les précédentes évaluations de l’Inra et d’Irstea par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) ayant eu lieu en 2016 et 2018, respectivement. Outre les activités d’INRAE, ce sont aussi la qualité des travaux de préparation et de mise en œuvre de la fusion de l’Inra et d’Irstea, le positionnement d’INRAE, sa stratégie, sa gouvernance et son pilotage que les experts ont examinés.

Extraits du rapport d'évaluation publié en octobre 2022 :
« Le comité a apprécié les efforts considérables qui ont mené à une fusion réussie de l’Inra et d’Irstea et à l’élaboration du plan INRAE 2030. [Il] considère que le nouvel organisme offre d’importants leviers contribuant à un positionnement de premier plan aux niveaux européen et international, à une riche fertilisation croisée entre les équipes de recherche issues des deux instituts ainsi qu’à une mutualisation réfléchie des activités support. [… Il] a constaté des progrès significatifs sur certaines faiblesses pointées lors des évaluations précédentes de l’Inra et d’Irstea. […]
Au cours de la période à venir, le comité estime qu’INRAE sera confronté à des demandes croissantes tant en matière de recherche que d’expertise et d’appui aux politiques publiques. L’institut devra faire des choix, et notamment prioriser ses partenariats. Il devra poursuivre le déploiement d’une culture de l’impact et surmonter un manque de capacité à mesurer et suivre en continu les impacts de ses activités. »
Agriculture, alimentation, environnement : des thématiques croisées
Les défis qu’INRAE veut relever avec ses partenaires dépassent les frontières géographiques et sectorielles. Nos approches doivent donc recouper celles de nos 3 piliers fondateurs que sont l'alimentation, l'agriculture et l'environnement pour intégrer leurs interactions. Elles nécessitent des démarches systémiques et interdisciplinaires pour proposer des réponses durables.
Six thématiques majeures, inscrites dans les objectifs de développement durable (ODD) :
- Changement climatique et risques
- Agroécologie
- Biodiversité
- Alimentation, santé globale
- Bioéconomie
- Société et territoires

Au service d’une recherche pluridisciplinaire et intégrative visant à répondre à des enjeux sociétaux mondiaux, l’organisation scientifique d’INRAE est construite selon une matrice spécifique. Afin d’accompagner et accélérer les transitions majeures attendues pour des systèmes agricoles et alimentaires durables, les recherches et travaux croisent 18 centres de recherche, intégrés dans des politiques de sites régionales à 14 départements scientifiques fortement impliqués dans des partenariats internationaux. Plusieurs métaprogrammes associant plusieurs départements permettent de construire ces approches interdisciplinaires. Des directions dédiées aux affaires internationales, à la science ouverte, à la valorisation, à l'expertise et à l'appui aux politiques publiques viennent en soutien à cette ambition scientifique. L’ensemble des directions ressources (ressources humaines, finances, achats...) est engagé dans une démarche d’efficience et de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) au service et en cohérence avec nos activités. La direction de la communication accompagne l’ensemble des agents d’INRAE dans le partage des connaissances et l’échange avec nos parties prenantes.
Carte d’identité de l'EPST
INRAE est un EPST, établissement public à caractère scientifique et technologique, créé le 1er janvier 2020 et issu de la fusion de l’Inra, Institut national de la recherche agronomique et d'Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. Il est sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation (MESRI) et celui en charge de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA). Il développe des collaborations importantes avec le ministère en charge de la Transition écologique et de la cohésion des territoires selon des conventions cadres dédiées.
Selon son décret fondateur (n° 2019-1046 du 10 octobre 2019), INRAE a pour missions
« de réaliser, d'organiser et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'État, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la gestion durable des territoires et des risques dans les champs de compétence précités.
« À ce titre, l'institut :
« 1° Produit, publie et diffuse les connaissances scientifiques résultant de ses travaux de recherche et d'expertise ;
« 2° Organise, en l'absence de dispositions ou clauses contraires, l'accès libre aux données scientifiques et aux publications ;
« 3° Concourt à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale et européenne de recherche ;
« 4° Apporte son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétence ;
« 5° Établit et met en œuvre des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
« 6° Contribue, par la valorisation de ses compétences, de ses savoir-faire et des résultats de la recherche, à la conception d'innovations technologiques et sociales ;
« 7° Contribue au développement de la capacité d'expertise scientifique et technologique, conduit des expertises et contribue aux activités de normalisation, en appui aux politiques publiques, aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, pour répondre aux enjeux du développement durable ;
« 8° Participe aux débats qui portent sur la place de la science et de la technologie dans la société. »
ET AUSSI
- 30,9 millions d'euros de recettes dont 9,1 millions d'euros de redevance (licences, savoir-faire, certificats d’obtention végétales).
- 10 000 ha d’expérimentation
Un peu d'histoire
INRAE est né au 1er janvier 2020, de la fusion entre l'Inra, Institut national de la recherche agronomique et Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Si l'Inra et Irstea ont été fondés après la deuxième guerre mondiale, leur histoire s'inscrit dans celle de la recherche publique française, en interaction avec les défis, les évolutions et les besoins de la société, en France et dans le monde.
Le Comité d'histoire d'INRAE contribue à la collecte et à la conservation des témoignages et des fonds documentaires, il mène et encourage la réalisation de travaux sur l’histoire d’INRAE, favorise les actions de publication, de valorisation et de communication sur l’histoire d’INRAE. Il promeut la réflexion sur la recherche scientifique en France, à la lumière des enseignements du passé. L'histoire que promeut le comité n’est pas seulement la connaissance du passé, elle est aussi un support de réflexion, à la fois pour les acteurs de la recherche, pour les décideurs et pour la société dans son entier. L'ambition est de les accompagner dans leur réflexion sur le rôle et la place des sciences agronomiques dans le monde contemporain.
IL Y A 100 ANS... de l’IRA à INRAE (1921-2021) :
« Deux lettres de différence et 100 ans d’écart, voici ce qui distingue au premier abord l’Institut de recherches agronomiques (IRA) créé en 1921 et INRAE, produit de la fusion de l’Inra et d’Irstea en 2020. Pour autant, l’IRA n’a pas constitué la maison fondatrice de la recherche publique sur l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ; plus modestement, il fut un jalon de la longue histoire de l’institutionnalisation de la recherche publique française. Et si certaines stations de recherche, notamment celle de Versailles, peuvent à bon droit revendiquer l’épisode de l’IRA comme la pierre angulaire de leur histoire, c’est paradoxalement plutôt la réflexion sur les difficultés et les fragilités de cette expérience des années d’entre-deux-guerres qui a permis d’initier, dans la seconde moitié du XXe siècle, un cycle plus robuste de développement de la recherche publique française, dont INRAE constitue la plus récente tentative d’adaptation aux défis de son époque. »
Philippe Mauguin PDG d'INRAE,
en introduction au texte de Pierre Cornu et Egizio Valceschini, Comité d'histoire d'INRAE